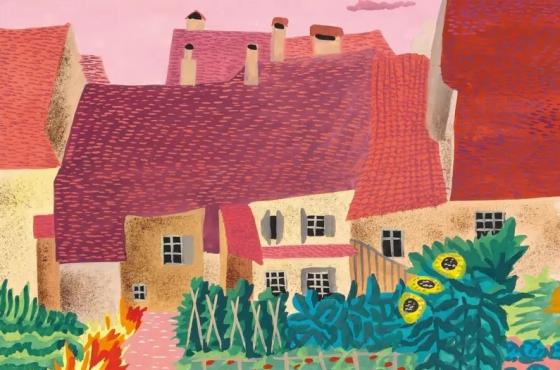Né en Égypte, élevé au Qatar, Omar El Akkad a émigré au Canada avant de devenir journaliste. Il a couvert l’Afghanistan, le Printemps arabe, Guantánamo, le mouvement Black Lives Matter. Ses romans — American War et What Strange Paradise — portent les traces de cette expérience de terrain : guerre civile, exil, dérèglement climatique, violence d’État. Mais quelque chose a basculé en octobre 2023. La violence venue de Palestine, d’une ampleur inédite, l’atteint directement. Depuis les États-Unis, ce pays qu’il avait idéalisé, il prend conscience que ses impôts financent les frappes qui tuent des enfants. Il ne peut plus se convaincre que cela ne le concerne pas.
Parler là où le silence a régné
Dans One Day, Everyone Will Have Always Been Against This, Omar El Akkad revient sur ses origines, les récits de son père après le départ d’Égypte, ses propres déplacements, et les tensions qu’il vit dans son rôle de père nord-américain. L’essai est traversé par une volonté de transmission. Il cherche les mots pour ne pas laisser à ses enfants le même silence qu’il a connu ou qu’il s’est lui-même imposé. Entre mémoire, héritage, et positionnement politique, il affronte les contradictions qui le traversent. Le rapport à la violence, à la résistance armée, à la loyauté familiale et politique : rien n’est simple.
Il écrit en refusant la posture de surplomb. Il ne juge pas les formes de lutte. Il interroge les siennes. Ce refus de trancher sur ce qu’il appelle « les formes légitimes de résistance » s’appuie sur un constat : l’occupation, la colonisation et les massacres sont des faits. Ce qui suit appartient aux personnes qui y survivent. Dans une interview à The Guardian, il explique : « En tant que journaliste pendant les années de la "guerre contre le terrorisme", couvrant un endroit comme Guantánamo, je pouvais encore mettre une certaine distance entre moi, mon rôle dans cette partie du monde, et ce que je voyais. (…) Je pouvais penser que c’était une anomalie — qu’en-dessous, il y avait une base de quelque chose de bon et de fondamental qui tiendrait. (...). Cette forme de défense psychologique m’est devenue inaccessible. (…) Tout cela est imbriqué, je pense, avec ma propre lâcheté d’avoir pu détourner le regard si longtemps. Je ne peux plus faire ça. »
« Il y a plus de gens investis dans la solidarité que dans l’anéantissement »
Ce livre est une critique de la complicité occidentale dans le génocide en cours à Gaza. Il décrit le prix moral de l’indifférence, et la manière dont les récits officiels permettent à cette indifférence de durer. Il s’en prend à une forme de libéralisme confortable : celui qui compatit, mais se retire dès que le coût devient concret.
Pour autant, El Akkad ne verse pas dans le cynisme. Il met en lumière des formes de résistance à contre-courant de cette indifférence : des médecins qui opèrent en zone de guerre, des dockers qui refusent de charger des armes, des étudiants d’universités prestigieuses prêts à sacrifier leurs privilèges pour une cause sans retour. Face à l’ampleur du désastre, ces gestes nourrissent chez lui une forme d’espoir et de courage.
Une présence à Bozar pour engager la parole
En septembre ‘25, Omar El Akkad est à Bozar, pour poser des questions et y répondre avec le public. Quel récit voulons-nous croire ? Jusqu’à quand resterons-nous silencieux ? Lire El Akkad, l’écouter, c’est commencer à se situer. Regarder ce qui nous effraie. Reconnaître notre place dans une crise mondiale. Sortir du réflexe d’impuissance, et penser la transformation à partir d’une exigence éthique. Dans ses livres comme dans ses prises de parole, El Akkad explore la peur, l’impuissance, le déracinement — non comme des faiblesses personnelles, mais comme des conditions politiques. Il montre comment les structures de pouvoir réécrivent l’histoire et normalisent la violence. Ses récits ne consolent pas, ils éveillent.